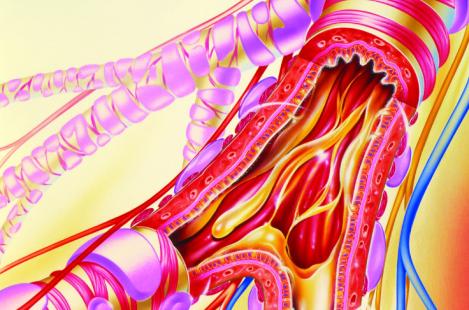De l’épidémiologie à la prise en charge, le congrès de la Société européenne de pneumologie (ERS, Barcelone, 4 au 6 septembre 2022) a accordé une large place à la BPCO, dont l’incidence serait fortement sous-estimée. Côté traitement, plusieurs études sont revenues sur des questions encore en suspens, comme l’intérêt des bronchodilatateurs chez des patients symptomatiques avec spirométrie normale ou la place des antibiotiques dans les exacerbations.
Alors que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) occupe la 3e place des causes de mortalité dans le monde, une étude de modélisation présentée lors du récent congrès européen de pneumologie suggère que la charge liée à cette maladie risque de peser encore davantage dans les prochaines décennies. Ce travail mené par une équipe américano-canadienne a réévalué la réalité de sa prévalence à l’échelle mondiale. Pour ce faire, les auteurs ont associé les cas dûment diagnostiqués de BPCO aux cas probables estimés sur la base des facteurs de risque connus. D’après leurs résultats, plus de 480 millions de personnes sur la planète souffriraient de BPCO ; un chiffre supérieur de 22 à 126 % aux estimations les plus citées aujourd’hui, qui font état de 212 à 392 millions de personnes atteintes de BPCO sur la dernière décennie.
600 millions de personnes concernées en 2050 ?
De plus, leurs projections estiment qu’en 2050, on comptabilisera près de 600 millions de personnes BPCO si les facteurs de risque restent inchangés, soit un bond de 23 % par rapport à 2020. Cette augmentation concernera en grande partie les femmes, leur nombre devant croître de 46,9 % pour atteindre 260 millions en 2 050. Une hausse beaucoup plus importante que celle attendue chez les hommes, chiffrée à 9,6 % pour atteindre un total de 332 millions. Le fardeau de la BPCO devrait aussi être avant tout porté par les pays aux revenus faibles et moyens (Afrique subsaharienne, Asie du Sud-Est et Pacifique).
Ces chiffres constituent un argument massue en faveur de la lutte contre le tabagisme et la pollution atmosphérique extérieure comme intérieure. Pour les auteurs, ces résultats devraient aussi « inciter les médecins à être plus vigilants en matière de dépistage et de test, car un traitement précoce peut améliorer la qualité et l’espérance de vie des patients ». Pointant un diagnostic souvent trop tardif du fait « d’une méconnaissance de cette pathologie, de la banalisation de la “bronchite du fumeur” et des symptômes souvent peu spécifiques », ils invitent à sensibiliser au repérage des symptômes à un stade précoce. « Nous pouvons réduire ce chiffre et contribuer à sauver des millions de vies grâce à l’éducation et à des actions significatives. »
Quatre études pour mieux traiter
Plusieurs études présentées à Barcelone se sont intéressées au traitement de la BPCO :
> L’essai ABACOPD s’est penché sur la place de l’antibiothérapie dans les exacerbations aiguës modérées de BPCO. Alors que la question fait régulièrement débat, cette étude n’a pas réussi à démontrer que le traitement antibiotique (ici par sultamicilline : pénicilline ampicilline/sulbactam) n’était pas nécessaire dans ce cas précis, quel que soit le stade de la maladie. Selon ce travail, alors qu’un traitement antibiotique semble inutile dans les stades Gold I/II, il ne peut être considéré comme tel dans les stades Gold III/IV, la non-infériorité du placebo par rapport à la sultamicilline n’ayant pu être démontrée.
> Une étude rétrospective a cherché à préciser le moment optimal pour débuter une trithérapie à inhalateur unique à la suite d’une exacerbation en se penchant sur la base de données américaine IQVIA PharMetrics. Ont été inclus les patients âgés de 35 ans ou plus avec un diagnostic de BPCO et des antécédents de tabagisme ayant présenté une exacerbation de la BPCO avec une initiation de fluticasone/uméclidinium/vilanterol (FF/UMEC/VI) dans les 180 jours. Les exacerbations ultérieures, les coûts médicaux et les réadmissions à l’hôpital ont été comparés entre les initiateurs rapides (≤ 30 jours) et retardés (> 30 jours). L’initiation rapide était associée à moins d’exacerbations et de réadmissions à l’hôpital et des coûts inférieurs.
> CELEB est le premier essai contrôlé randomisé ayant comparé, dans l’emphysème, la réduction du volume pulmonaire par voie endoscopique, via la pose de valves endobronchiques (disponibles depuis deux ans en France), à la chirurgie de réduction classique. Les résultats sur 98 patients ont conclu au match nul avec des bénéfices similaires. Les améliorations ont concerné la réduction du volume résiduel (chirurgie : -36,1, bronchoscopie : -30,5 ; p = 0,91) ainsi que le score i-BODE total (chirurgie : -1,10, valves endobronchiques : -0,82 (p = 0,54)) et chacun de ses paramètres : IMC, obstruction des voies respiratoires, dyspnée, capacité d’exercice. Le profil de sécurité semblait comparable avec un décès dans chaque bras après un an. Pour le Pr Laurent Guilleminault (service de pneumologie, CHU de Toulouse), « les valves endobronchiques prennent progressivement le pas sur la chirurgie et cette étude montre bien que tout en étant moins invasif, on est tout aussi efficace. Chez des patients BPCO emphysémateux sévères dont la dyspnée persiste malgré une prise en charge optimale, il faut solliciter un avis d’expert vis-à-vis de leur éligibilité à un traitement endoscopique interventionnel de réduction pulmonaire. »
> Une autre étude s’est intéressée au microbiote dans la BPCO et a examiné pour la première fois les effets de la réhabilitation respiratoire (RR) sur le microbiote buccal des personnes atteintes de BPCO (456 échantillons provenant de 76 patients). La RR a modulé la composition du microbiote, avec un enrichissement en Proteobacteria (Haemophilus) et une déplétion en Bacteroidetes, connus comme étant associés à une sévérité accrue.